Nos ruines contemporaines : un autre déni ?
Dans deux articles publiés dans la revue Vacarmes, la directrice en chef de la revue Incise, Diane Scott, analyse une sensibilité artistique et culturelle, orientée vers la ruine [1]. Si les ruines évoquent régulièrement les investigations archéologiques de l’Antiquité, la particularité de cette tendance actuelle est qu’elle est centrée sur les ruines du XXe siècle : ces ruines sont celles d’un passé proche et par conséquent, sont les nôtres.
Le Ruin Porn
Bien que l’objet industriel (machine et architecture) réapparaisse par le biais du paysage, il est aussi pleinement visible, voire trop, derrière une tendance esthétique générale et forte de la ruine. À ce titre, si peu de photographies se sont attardées à représenter la crise de l’industrie lourde des années 1970 lorsqu’il était « temps », une multitude de photographes sont actuellement attirés par les vestiges que celles-ci a laissé, tels les « Urbexeurs » qui se faufilent dans des usines abandonnées et de préférence, interdites d’accès [2]. D’autres photographes s’intéressent aussi aux conséquences laissées par la crise sur l’urbanisme notamment dans la ville de Détroit. Le photographe Thomas Jorion par exemple écrit dans son ouvrage Ilots intemporels [3] :
« Si l’on compare le Japon et l’Amérique, on remarque que, chez ce dernier, les crises ont été bien plus profondes que l’on peut l’imaginer depuis l’Europe. L’espace constructible y étant presque illimité, la règle du “construire neuf plutôt que de réhabiliter” a laissé des marques. C’est bien sûr le cas à Détroit (Michigan), où le “white flight” a amplifié le phénomène […][4] ».
Détroit fut une ville caractéristique de l’industrie de l’automobile américaine au début du XXe siècle en se constituant selon les « règles » d’un capitalisme sauvage —comme l’écrivait le sociologue français Pierre Bourdieu (1930-2002)[5]— elle ne livre aujourd’hui que son perpétuel déclin, marqué par les inégalités sociales. La désindustrialisation des régions au sud des grands lacs du Michigan a attiré un grand nombre de photographes et artistes, comme Stan Douglas à Chicago [6], Mitch Epstein à Cheshire [7], ou encore Martin Zellerhoff à Rochester (2007)[8], l’un des seuls à avoir photographié la démolition d’une usine, et il s’agissait de Kodak. Dans ce contexte, Détroit a aussi été le sujet des photographes français Yves Marchand et Romain Meffre pour leur série The Ruins of Détroit réalisée en couleur, entre 2005 et 2009.
Le spécialiste anglais de la photographie, David Campany, soumet l’hypothèse que cette tendance à la ruine aurait été déclenchée par un événement traumatique récent dans la conscience mondiale, traumatisme maintes fois répété par l’image (comme l’avait aussi relevé Clément Chéroux dans son essai [9]). Cet événement qui ne se présente plus est celui de l’effondrement du World Trade Center en 2001 dont les ruines ont été documentées par le photographe américain Joel Meyerowitz, seul photographe autorisé sur les lieux [10]. Ce serait donc suite à cet événement (celui-ci sera suivi par d’autres phénomènes catastrophiques), que ce type d’image s’est généralisé comme l’explique aussi Diane Scott : « Comme si la catastrophe était une des scènes où se lissait, se coordonnait une culture globalisée […][11] » produisant alors « une sauce mainstream [12] ». Mais la photographie s’intéresse à la ruine depuis longtemps et cet attrait a en réalité commencé dès les années 1980. À titre d’exemple on pourrait ainsi citer parmi tant d’autres, la série autour de l’archéologie industrielle du photographe belge, Gilbert Fastenaekens réalisée pour la Mission photographique de la DATAR dès 1984 [13], la série Deathtopia publiée dans un ouvrage du même nom en 1998 par le photographe japonais Shinichiro Kobayashi [14], ou encore l’exposition « La suite du temps » qui s’est déroulée en 2015 au musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne qui alors réunissait les travaux photographiques du français Yves Bresson et de l’italien Massimiliano Camellini [15]. Ces images de ruines ont pris une telle proportion que David Campany finit par constater :
« De telles images ne se rencontreraient-elles pas que dans l’art contemporain, il serait loisible de n’y voir qu’une vogue passagère […]. Or, elles sont de plus en plus présentes dans le nouveau photojournalisme, le documentaire, les campagnes de communication, et jusque dans les informations, la publicité et la mode. Ceci laisse à penser que la photographie a depuis peu hérité d’un rôle de croque-mort, de greffier, ou de comptable [16] ».

Thomas Struth, hot rolling mill, 2010
L’excès des productions approchant la ruine révèlent, parmi-elles, un grand nombre d’usines. De ce fait, ce type de photographie a eu pour effet de cantonner l’usine à un aspect qui se rapportait à celui de la ruine. De surcroit, ce goût pour le vestige semble être par ailleurs ce qui aurait enfermé l’industrie dans une image de « désindustrialisation » en détournant la définition d’origine de la société post-industrielle (le passage au secteur tertiaire) en une vision plus orientée vers un temps de l’industrie désormais, terminé. En effet, lors du colloque « L’art et la machine » organisée en hiver 2015 au Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne en France, Julie Noirot (Maître de conférences à l’université de Lyon) posait la question de savoir où était passé la machine ? Et donc l’industrie. Qu’en est-il en effet de sa représentation actuelle, depuis le bilan des Becher qui était en lien avec le désenchantement contextuel vis à vis de l’industrie ?[17]
L’usine contrainte à l’image de ruine
Selon Julie Noirot, l’industrie n’aurait pas totalement disparue et résiderait encore en tant que vestige. Ce qui interrogerait également selon elle, les limites du photographique à l’ère du numérique [18]. De ce fait, elle associe surtout cette « nouvelle » esthétique au terme de « post-industriel ». En effet, la particule « post » engage une notion de temps qui est celui de l’après. Or la photographie s’est penchée sur cette esthétique de « l’après », matérialisé notamment auprès des pratiques de la Late photography généralisée autour des années 2010. Par conséquent, puisque la réflexion de cette photographie est relative à la question du temps de l’après, la ruine apparaît comme une évidence puisqu’elle garde les traces des évènements du passé.
Les photographes français Yves Marchand et Romain Meffre ont réalisé depuis 2002 un travail commun autour de la ruine, visible dans les séries The Ruins of Détroit, Theater, Gunkanjima et, récemment, Industry [19]. Cette dernière représente en couleur des usines, des salles de machines, ou des halles de productions industrielles, comme si finalement ces espaces s’inscrivaient indéniablement à la suite d’un travail sur le temps de l’après.
Volontairement inspirés de l’école de Düsseldorf, les photographes Yves Marchand et Romain Meffre ont une approche froide, distanciée ou, pour reprendre David Campany, « médico-légale [20] » en usant de cadrages horizontaux afin de mieux représenter l’espace. Dans un contexte de ruine il est néanmoins difficile de déterminer s’il s’agit d’une vue intérieure ou extérieure, puisque les objets industriels tels que générateurs ou tuyaux, sont quasiment tous recouverts d’herbes sauvages ou de mousse. Les morceaux de murs ou de toit n’empêchent pas non plus la neige de passer et de recouvrir le sol, comme dans ce hall d’usine historique d’origine berlinoise, Borsig, qui fabriquait des locomotives et représenté – ou du moins ce qu’il en reste – dans l’image Hall, Borsig Factory, prise à Eberswalde.

Yves Marchand et Romain Meffre, Hall, Borsig Factory, Eberswalde, Allemagne, 2007, épreuve à développement chromogène, 95 x 120 cm, 150 x 190 cm, série « Industry », Galerie Polka, Paris. ©Yves Marchand et Romain Meffre
Comme le rappelle Diane Scott à travers une autre comparaison, cette image de Yves Marchand et Romain Meffre offrant une vision d’un lieu abandonné se confronte et s’oppose à celle d’un temps qui sut mettre à l’honneur l’industrie. Se crée alors une sorte de pont vers le passé. Par exemple, l’image Hall, Borsig Factory fait écho au temps de la locomotive, comme avec le film historique dans le domaine du cinéma, L’arrivée d’un train à la gare de la Ciotat de 1896 réalisé par Louis Lumière (1862-1954). Quoi de mieux en effet, que l’image animée pour représenter la vitesse de la locomotive, et quoi de mieux que la photographie pour figer éternellement dans le temps, le hall d’un ancien fabricant de locomotive désormais déserté. Cependant, et bien que l’approche photographique de Yves Marchand et Romain Meffre se veuille neutre, ce rappel à un temps qui fut, mais qui n’est plus, est suggéré par les images parce qu’elles s’appliquent à représenter des lieux particulièrement vastes. La taille des vestiges est en effet conséquente et fait écho à la gloire dont était emprunte ces lieux, pendant que la rouille et l’usure rappellent qu’il s’agit désormais d’une histoire ancienne. De ces lieux se dégage alors une atmosphère mélancolique, comme s’ils étaient à eux seuls des sortes de gardiens du souvenir.

Yves Marchand et Romain Meffre, Generator room, Port Richmond Power Station, Philadelphia, 2007, épreuve à développement chromogène, 95 x 120 cm, 150 x 190 cm, série « Industry », Polka Galerie, Paris. ©Yves Marchand et Romain Meffre
C’est dans cette même approche distanciée de machines industriels et « d’intérieurs » d’usines cruellement misent à nue et réduites à l’état de friche que Gilbert Fastenaekens utilise l’effet testimonial de la photographie pour révéler la nostalgie de l’espace usinier dans la région de la Lorraine : « La photographie aime à jouer de sa réputation d’objectivité pour faire prendre des illusions pour des certitudes [21] ». À l’instar des ruines antiques, ces vues prises de nuit nient la présence humaine et renvoient à la vanité de l’homme en lui offrant l’image de sa grandeur passée devenue poussière. Impossible également de ne pas relever la dimension théâtrale et poétique de l’image de l’usine fantomatique révélée par un jeu de couleur. Chaque espace a en effet sa couleur prédominante, ce qui favorise son aspect irréel [22]. Mais le phénomène de séduction dont use Gilbert Fastenaekens met en avant une certaine contradiction, liée à une réalité contemporaine qui est, encore une fois, la négation de la réalité du travail.

Gilbert Fastenaekens, Dombasle, France, 1985, ektachrome, tirage cibachrome,10,16 x 12,7 cm, Bibliothèque nationale de France ; galerie les Filles du Calvaire, Paris.
© Gilbert Fastenaekens ; Mission photographique de la DATAR
En effet, présenter la ruine en tant que preuve documentaire confère un rôle à ce type de photographie qui semble rassurer, parce que la perte est irréversible. La ruine industrielle apparait en ce sens comme un signe qui ponctue le présent comme étant le seul progrès. La photographie et la ruine assurent toutes deux qu’il s’agit là d’un temps fini. Plus de crainte à avoir donc, puisque le capitalisme et ses effets nocifs sont passés, le présent est « supérieur » et vit dans une démocratie libérale. Diane Scott écrit : « […] Le XXe siècle est bel et bien fini, et son triptyque historique, la chaîne métonymique industrie-ouvrier-idéologie est elle aussi obsolète. La classe ouvrière est l’absente manifeste dont nos ruines martèlent la disparition et, par glissement, celle conjointe et idéologiquement surdéterminée, du totalitarisme et de la gauche réunies [23] ». L’approche du réel de l’usine semble dans ce cas soutenir ce que Diane Scott nomme « un discours néo-progressiste » qui n’aime l’image que parce que l’industrie appartient au passé. Elle compare d’ailleurs cela au phénomène de mode qui consiste à chiner le mobilier industriel pour la décoration intérieure et qui serait un détournement possible seulement parce que toutes les formes industrielles sont admises comme primitives.
L’idée que l’usine du XXe siècle avait disparue a été exprimée de manière efficace par les films américains dès les années 1970, nombreux à avoir été tournés dans ces friches pour les fusillades et confrontations et ce au milieu de murs miséreux, suintants sous l’humidité et la pluie. Ainsi, l’usine a été reléguée aux villes marginales ou à des bâtiments accueillants les criminels. Désormais, cette passion pour la ruine s’est amplifiée et concerne autant les jeux vidéo que le cinéma, comme Diane Scott le relève dans certains films récents, tels que Only Lovers Left Alive de Jim Jarmush (2014), Gone Girl de David Fincher (2014), ou encore dans les blockbusters tels que Skyfall de Sam Mendes (2012) ou The Dark Knight Rises de Christopher Nolan (2012) dans lesquels les héros ressuscitent en passant de « ruines » à « super héros » comme s’il s’agissait de rassurer sur le fait que l’Occident ne meurt pas. Qualifiée de genre « Post-apocalyptique », de « Ruinomania » ou de « Ruin porn » – pour mieux illustrer la séduction menée à la lassitude à cause de son excès – l’image de ruine est donc partout mais est surtout représentative du discours de la fin du capitalisme. À travers ces divers médiums (cinéma, jeux vidéo, presse, photographies, télévision, etc.) il est à relever que les grands symboles de ce que fût la modernité industrielle tels que l’automobile, l’avion ou le building, présentent leurs restes après explosion, crash, ou effondrement et sont des motifs représentatifs d’un engouement pour des lieux abandonnés par une industrie d’un autre temps. Du reste, si au départ le cliché de cette tendance à la ruine s’est voulu, selon David Campany, documentaire au point d’être comparé à une photographie « médico-légale [20] », les vestiges impliquent au présent une projection imaginaire de l’événement passé. Le vestige engendre alors des liens entre la mémoire et l’histoire, et il conviendrait de relever qu’au-delà du simple constat, les conséquences de la dévastation projetée sur l’usine ont également servi à créer une atmosphère particulièrement propice à l’étrange ou à la fiction.
©ArtSphalte
Références :
[1] Scott Diane, « Nos ruines », Vacarme.org, n° 60, 26 juin 2012. Scott Diane, « Retour des ruines », Vacarme.org, n° 70, 22 janvier 2015.
[2] Muller Pierre-Henry, « Urbex exploration urbaine, l’archéologie de notre récent passé », boreally.org, sans date.
[3] Jorion Thomas, Ilots intemporels, s. l., Thomas Jorion, 2010. Réed. 2012.
[4] Ibid., p. 5.
[5] Bourdieu Pierre, Contre-feux : propos pour servir à la résistance contre l’invasion néo-libérale, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1998, Vol. 1.
[6] Douglas Stan, Pakesch Peter, Zürcher Isabel, Le Détroit, cat. exp., [31 mars 2001-27 mai 2001, Kunsthalle, Bâle], Bâle, Kunsthalle, 2000.
[7] Epstein Mitch, American Power, Göttingen, Steidl Verlag, 2009.
[8] Zellerhoff Martin, Ran ans Motiv !, Cologne, Snoeck, 2015. Nous n’avons pas pu accéder à cet ouvrage.
[9] Chéroux Clément, Diplopie. L’image photographique à l’ère des médias globalisés : essai sur le 11 septembre 2001, Paris, Le Point Du Jour, 2009.
[10] Campany David, « Pour une politique des ruines: quelques réflexions sur la “photographie de l’après” », dans Criqui Jean-Pierre, Dufour Diane, Vidal Christine, et al., L’image-document, entre réalité et fiction, Paris, Le Bal ; Images en manœuvres, coll. « Les carnet du Bal 01 », 2010, p. 48-67.
[11] Scott Diane, « Nos ruines », art. cit., s. p.
[12] Ibid.
[13] Fastenaekens Gilbert, Essai pour une archéologie imaginaire, Bruxelles, Art and Research Publishing, 1994.
[14] Kobayashi Shinichiro, Deathtopia, Tokyo, Media Fakutorī, 2000.
[15] Bresson Yves, Camellini Massimiliano, La suite du temps, cat. exp., [14 février-17 mai 2015, Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Étienne], Turin, Hapax Editore ; Saint-Étienne, Musée d’art moderne et contemporain, 2015.
[16] Campany David, « Pour une politique des ruines : quelques réflexions sur la “photographie de l’après” », dans Criqui Jean-Pierre, Dufour Diane, Vidal Christine, et al., L’image-document, entre réalité et fiction, op. cit., p. 51.
[17] Noirot Julie, « La machine délaissée dans la photographie contemporaine », L’art et la machine. L’image appareillée, [Intervention pour colloque, 16 octobre 2015, Musée d’Art moderne et contemporain, Saint-Étienne].
[18] On se fera un plaisir d’y apporter une réponse prochainement.
[19] Marchand Yves, Meffre Romain, Industry, cat. exp., [8 novembre 2014-17 janvier 2015, Polka Galerie, Paris], Paris, Polka Galerie, 2015.
[20] Campany David, « Pour une politique des ruines : quelques réflexions sur la “photographie de l’après” », dans Criqui Jean-Pierre, Dufour Diane, Vidal Christine, et al., L’image-document, entre réalité et fiction, op. cit., p. 50.
[21] Caujolle Christian, Nourissier François, Seylan Djan, L’usine. Thierry Girard, John Vink, Richard Kalvar, Gilbert Fastenaekens, Biarritz, Les Éditions Contrejour, 1987, p. 56.
[22] Ibid.
[23] Scott Diane, « Retour des ruines », art. cit., s. p.
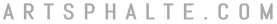
Rétroliens/Pings