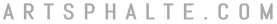“Je suis à la fois : celui que je me crois, celui que je voudrais qu’on me croit” G. Bataille
Photographe français attaché à l’agence photo Magnum depuis 2004, Antoine d’Agata tourne des films et publie de nombreux ouvrages mêlant photographies et textes. Le dernier en date est Désordres, sorti en 2015 et édité par les éditions Voies Off à Arles.
Un âne qui couche avec une femme, des combats de coqs, des chiens qui montrent leurs crocs et surtout des femmes, rythment les photographies d’Antoine d’Agata. Ces femmes sont désarticulées par un cadrage ou floutées à cause d’un appareil trop tremblant pour réaliser une image nette. Là, des enfants nous montrent leurs dos parce qu’eux aussi sont impossible à photographier, eux aussi sont sans identité fixe. Les corps convulses ou au contraire sont aussi statiques que des papillons épinglés qu’on aimerait voir bouger. Hystériques, ils sont perdus dans un labyrinthe angoissant et dans lequel le temps ne semble plus exister. Dans cet enfer, le photographe garde volontairement l’histoire de ces personnages sous silence parce que seul la blessure qui les unit entre eux l’intéresse. Ce lien, que Camille Pagla a nommé le Kinship, ce lien qui rassemble ceux que la société éloigne d’elle en en faisant des monstres parce qu’ils n’obéissant qu’aux lois de la nature, à l’instinct ou au hasard. Bien sûr, Antoine d’Agata maintient un travail d’une tonalité négative qui hurle sans cesse la lamentation ce qui offre une vision biaisée de la réalité. Il ne le nie pas, il sait que la photographie ment.
Ces femmes qu’il photographie, la société les appelle « prostituées », ou parfois « esclaves ». Pourtant, le photographe rappelle sans cesse qu’il ne photographie que des femmes libres. Un renversement de perspective qui brise les certitudes et donc oui, Antoine d’Agata dérange. Il dérange la bien pensante et les pseudos féministes. Son travail leur tend leur reflet de « pseudo ». Lui ne juge pas. Il n’essaie pas de comprendre. Il traverse les rues et les bordels pour mieux s’y noyer. Il n’observe pas de loin, il participe, c’est tout. C’est de toute façon le deal qu’il doit tenir pour que ces femmes se laissent aimer. En font-ils tous autant ? De fait, quand Antoine d’Agata expose “1001 Nuits”, ses photographies tapissent les murs dans tous les sens et semblent explorer toute la palette des formats. Ses images sans titre indique seulement le pays de la prise de vue et nous immerge dans un nouveau genre de mappemonde. Un voyage qui parcourt les terres et qui nie toute forme de frontière afin d’offrir l’image d’une violence humaine et universelle. Antoine d’Agata force le passage au centre des conflits et est en cela représentatif de Magnum. Il couvre entre autre, la frontière du Mexique, Gaza, la Lybie, ou encore des révoltes à Jérusalem. Il écrit dans son Manifeste :
« Répugnant à jouer le rôle de voyeur, confronté dans l’urgence aux aspects les plus dérisoires de la pratique photographique, je suis finalement le témoin de mon manque d’expérience, de mon impuissance devant la violence imbécile du plus fort sur le plus faible, de la propre situation à l’intérieur du chaos. […] Il est urgent de mettre à nu les contradictions inhérentes à la fonction du photographe documentaire, censé retranscrire une réalité prédéfinie alors qu’il ne relate qu’une somme d’expériences. Dans un équilibre sans cesse remis en question entre la volonté d’informer et une subjectivité inéluctable, la photographie doit aujourd’hui interroger son articulation au réel et le sens que produit cette confrontation. »(Manifeste, Lyon, Galerie Le bleu du ciel / Cherbourg, Le Point Du Jour, 2005, p. 17.)
Bref, si Antoine d’Agata est souvent décrit comme une espèce d’ogre monstrueux, on préfère le décrire comme un clébard débordant d’amour. Juste un peu trop fatigué pour se laisser emmerder.
Pour aller plus loin…
Le reportage de l’intime
Pour comprendre la pratique photographique d’Antoine d’Agata, remettons la dans un contexte historique et photographique qui prend racine dans les années 1970. Années qui connaissent un essor mass-médiatique. La presse papier doit aller vite, coller à l’actualité, se diffuse massivement et la photographie doit suivre le rythme. L’efficacité d’une photographie capable de résumer une histoire en une image est donc appréciée par la presse. Celle-ci récupère les préconisations du photographe français Cartier-Bresson et de son « instant-décisif ». Au tournant des années 1980, une pratique photographique prônant le reportage sur le long terme vient s’opposer à ce culte de l’instantané et critique la valeur documentaire de cette dernière. Celle-ci se voit reprocher de n’offrir qu’une vision fragmentaire d’un monde bien plus vaste et de toute façon, impossible à photographier dans son ensemble.

Anders Petersen, série “Café Lemitz”, réalisée entre 1967 et 1970. Crédits photographiques Anders Petersen
Le reportage sur le long terme et la subjectivité offraient alors des alternatives pour le photographe qui cherchait à rester suffisamment longtemps dans un milieu afin d’être au plus proche du vrai. Le photographe américain Anders Petersen par exemple, ne reste pas à l’écart de ce qu’il voit, et impose par son cadrage sa propre vision du monde illustré par Café Lehmitz publié en 1978.
Ces photographes ont un regard différent, plus personnel et engagé. Ils décident de photographier leur propre quotidien marqué par des réalités sociales complexes comme le racisme, la drogue, la pauvreté, et notamment la peur de la mort (apparition du sida).

Nan Goldin, Nan, one month after being battered, 1984. Crédits photographiques Nan Goldin
La photographie « ratée » ou l’esthétique amateur est récupérée par la photographe américaine Nan Goldin afin de retranscrire son quotidien et surtout son ressenti. Les cadrages approximatifs, les flous, les lumières trop sombres ou trop claires, viennent renforcer une atmosphère de l’intime ou viennent témoigner de la fulgurance d’un moment. Ayant étudié auprès de Nan Goldin et Larry Clark dans les années 1990, Antoine d’Agata court après une vérité qu’il sait chimérique. Sa démarche est à rapprocher des préceptes de Guy Debord et du mécanisme de George Bataille.
Politiquement incorrect
Si on se penche d’un peu plus près sur les images de D’Agata, on remarque une volonté évidente d’esthétiser son sujet. De fait, sa photographie est sujette à controverse. On accuse le photographe d’entretenir le marché de la prostitution et de rendre esthétique la douleur. De plus, ces images avec des flous, des couleurs prédominantes de bleu ou de rouge produisent un amalgame entre le monde de la nuit (le réel) et l’univers du diable (la fiction), ce qui a de quoi hérisser le poil.
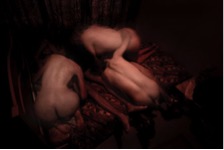
Antoine d’Agata, Sans titre, Brésil, 2008, image extraite de NÓIA. Crédits photographiques Antoine d’Agata / Magnum
À être dans l’extrême, Antoine d’Agata crée une caricature et des analogies qu’il n’a pas été le seul à faire entre la femme et l’hystérique, la prostituée et le diable, (trop) visible dans le cinéma d’horreur ou la littérature. D’ailleurs Leslie Kaplan le critique violemment et lui reproche son manque de questionnement quant à la prostituée, puis le compare à un « jeune vieux touriste qui croit partir pour une aventure si exotique se retrouve débitant ses banalités et exhibant ses clichés » dans les Tribunes de Libération le 19 mars 2003. Mais est-ce vraiment aussi simpliste ? Surtout si on rappelle que d’Agata admire les femmes qu’il photographie : « Je suis prêt à défendre la vérité de ma position par rapport à elles, parce que ces femmes sont incroyables […] Ça m’insupporte qu’on puisse porter des jugements moraux » répondit Antoine d’Agata à Claire Guillot dans un article du Monde le 27 et 28 janvier 2013. C’est ici que le mécanisme de Bataille (voire celui de Sade) entre en jeu et vient contrecarrer les critiques. Et si en fait, Antoine d’Agata était plutôt un défenseur de la femme ?
L’informe

Antoine d’Agata, Sans titre, 2013, image extraite de Aka Ana. Crédits Antoine d’Agata
Antoine d’Agata évoque sans arrêt l’échec de saisir l’identité de son sujet. Peut on réduire l’identité, ou plutôt, les identités d’une personne à un seul de ses aspects ? Est-ce que l’image d’une personne triste, signifie que cette personne est triste en permanence ? Est-elle triste dans tous les autres aspects de sa vie, ceux qui échappent à la photographie ? Bien sûr que non. Roland Barthes l’avait aussi remarqué lorsqu’il a écrit dans La Chambre claire : « Or dès que je me sens regardé par l’objectif, tout change : je me constitue entrain de ‘‘poser”. […] Devant l’objectif, je suis à la fois : celui que je me crois, celui que je voudrais qu’on me croit, celui que le photographe me croit, et celui dont il se sert pour exhiber son art. » La figure de l’hystérique et la figure de la prostituée (comme l’avait compris Balzac avec son personnage Esther dans son roman Splendeur et misère des courtisanes) ont en commun le fait d’avoir plusieurs identités. Elles se fondent, se métamorphosent et s’autodétruisent afin de mieux se mouvoir sous de nouvelles formes. La contradiction de la rencontre entre l’appareil et le sujet est que l’appareil fournit une image immobile tandis que le sujet est toujours mobile, à la fois unique et multiple. Le visage volatil est parcouru de variations infinies dont l’appareil ne peut en arracher qu’une séquence.
On comprend ainsi mieux pourquoi d’Agata fait souvent référence à l’auteur portugais Fernando Pessoa dans ses écrits, puisque le nom même de Pessoa signifie en français « personne ». Qu’est-ce que la liberté si ce n’est l’absence de toute forme de délimitation, dont celle de l’identité ? Les flous qui détruisent les corps des femmes dans les images de d’Agata pulvérise dans le même temps, toute notion identitaire. Adieu « la douce », « non violente », « maternelle » figure de la femme. Mais pourquoi une mise en scène si caricaturale ?
L’historien de l’art et philosophe George Didi-Huberman, réalise une analyse intéressante de l’informe batallien dans son ouvrage La ressemblance de l’informe, ou le gai savoir visuel selon George Bataille (1995) qui pourrait s’appliquer à la démarche de D’Agata. Il s’agit en effet d’user de l’artifice de l’antithèse, visuelle ou verbale, pour créer une transgression qui révèlerait une autre réalité. Cette transgression crée une fissure concernant un tabou. Plus la forme que l’on attaque est solide, plus la forme attaquante doit être excessive. L’informe est le combat de la forme contre la forme. Seulement, pour que la réalité soit toujours apparente, ce combat ne doit pas prendre fin. D’Agata use donc de la disproportion afin d’ébranler un sujet tabou.
Un combat désuet ?
Attaquer la religion, la société, le capitalisme, etc. par l’excès, est un combat qu’on aurait pu penser passéiste. Du reste, dans la sphère culturelle, entre les artistes se recouvrant d’excréments ou ceux plongeant un crucifix dans de l’urine, on vous dira : « on a vu pire !». Oui, mais. Cet argument ne viendrait-t’il pas nier l’existence d’un public qu’il est nécessaire de provoquer et qui est en général, lui aussi extrémiste ? La fermeture du musée d’Ajaccio en 2014 sous la pression des intégristes corses et du Civitas à cause de l’œuvre Piss Christ d’Andres Serrano ne vient-il pas prouver le contraire ? Et pire, les évènements de janvier 2015 contre les caricaturistes de Charlie Hebdo ne sont-ils pas venus mettre en avant cette autre réalité dont parlait Bataille : celle que les libertés ne sont jamais acquises. Se plonger dans le tabou pour ébranler les convictions devient un combat essentiel et malheureusement, actuel.
La prostituée
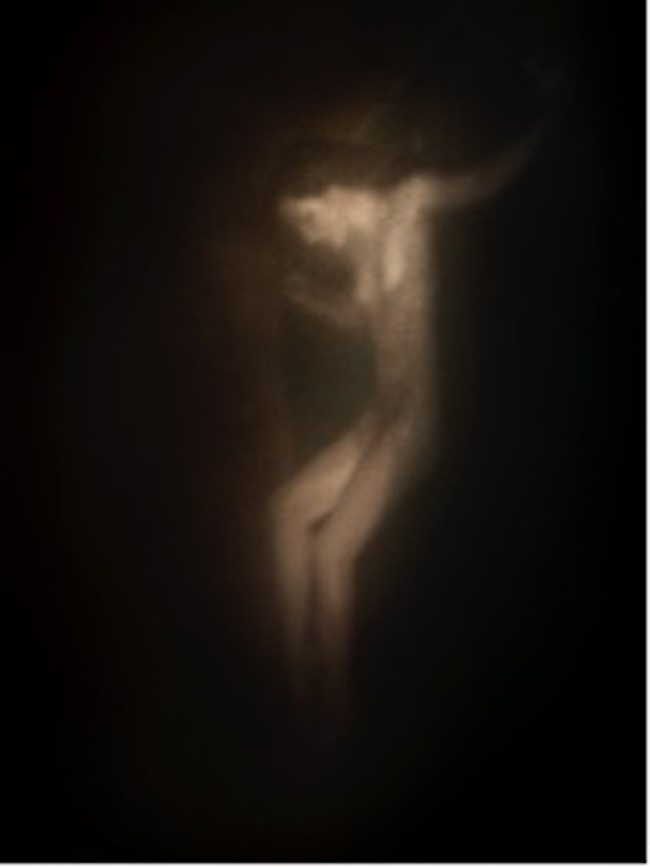
Antoine d’Agata, Sans titre, Géorgie, 2009, image extraite de NÓIA. Crédits photographiques Antoine d’Agata
La prostituée souffre d’un cliché arbitrairement « éternel » qui considère la travailleuse du sexe comme étant une esclave. Son métier est donc dégradant et suscite de nombreux débats restant largement discutés en France, bien que ce pays semble être entré dans un processus d’abolition définitive à une échelle européenne. Pourtant, bien que la prostitution soit encore une fois qualifiée excessivement de « plus vieux métier du monde », les historiens datent de cinq mille ans avant Jésus Christ les premiers témoignages de la pratique ou en d’autres termes, dès le berceau du système économique. À l’inverse et selon Plutarque, la prostitution n’existait pas à Sparte car il s’agissait d’une société dénuée de tout système économique ou d’organisation hiérarchique. La prostitution semblerait donc inhérente à un système marchand et à son organisation sociale.
Vouloir abolir la prostitution ne servirait donc à rien si ce n’est que cela lui engendrerait encore plus de difficulté à survivre en ne traitant pas la racine du problème. Vouloir l’anéantir est très loin d’une prétendue démarche humanitaire car elle fait partie intégrante du système capitaliste.
D’Agata tire plutôt le portrait de ce pacte Faustien entre le créateur et la créature puisque la prostituée existera tant que la société sera, et ce dans une sorte d’ordre imposé au chaos du monde qu’il ne cherche pas à raisonner. Elle reste le récepteur d’une misère sexuelle qui pose en réalité des problématiques bien plus profondes ne concernant pas réellement la prostituée mais bien, ce qui l’a créé. Elle touche un point sensible en revenant sans cesse et la tentative de la positionner parmi les “sans-part” (Jacques Rancière) sera à jamais un échec.
Critique du capitalisme ?

Antoine d’Agata, Sans titre, Hambourg, 2002. Crédits photographiques Antoine d’Agata / Magnum
L’autre reproche qui peut être fait au photographe est l’usage de l’image du sexe. Elle est en effet contradictoire avec sa contestation du capitalisme car il est vrai que des culs, on en voit un peu partout et… tout le temps. Bref, le marché du cul, ça marche bien. Seulement bien qu’il qualifie lui même son travail de pornographique, on ne peut pas réellement appuyer Antoine d’Agata sur ce sujet, sauf s’il s’agit d’une autre pornographie dont lui seul aurait la définition.
Frédéric Tachou enseignant en analyse du cinéma expérimental, explique dans l’ouvrage Et le sexe entra dans la modernité : photographie obscène et cinéma pornographique primitif (2013) que le propre d’une image pornographique est non seulement de combiner fiction et réalité, mais surtout d’offrir à la scrutation de l’œil une vision exhibée du sexe dénué de sentiment afin de provoquer l’excitation sexuelle du regardeur. Et on ne peut pas vraiment dire que les images de d’Agata évoque le glamour et l’excitation. D’abord parce que ce dernier ne parle que de sentiment, mais aussi parce que les corps ou les sexes s’exhibant dans ses images ne sont pas « beaux» dans le sens où ceux-ci n’entrent pas dans la conception canonique actuelle où toutes les aspérités se verraient gommées afin de susciter le désir. Qualifier les travaux de d’Agata de « pornographique » serrait donc une erreur.
©ArtSphalte